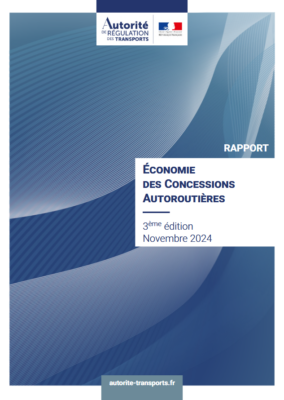
Paris, le 30 novembre 2024 – Conformément à l’article L 122-9 du code de la voirie routière, l’Autorité de régulation des transports (ART) publie aujourd’hui son troisième rapport sur l’économie générale des concessions, consacré aux enjeux posés par la fin des concessions historiques. Alors que l’échéance des sept plus grandes concessions est proche, le rapport souligne que les obligations de fin de contrat doivent être précisées pour permettre leur achèvement dans de bonnes conditions et chiffre à plusieurs milliards d’euros les enjeux financiers associés.
LA REMISE EN BON ÉTAT DES OUVRAGES EN FIN DE CONCESSION PRÉSENTE DES ENJEUX SPÉCIFIQUES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC AUTOROUTIER
À ce jour, l’état d’entretien des autoroutes concédées est objectivement bon. Les comparaisons avec d’autres réseaux l’attestent : les ouvrages d’art et la chaussée sont en meilleur état que sur le réseau non concédé et la France se situe généralement en tête des classement internationaux concernant les infrastructures autoroutières.
Des mesures propres sont toutefois nécessaires en fin de concession afin de garantir la continuité du service public autoroutier. En effet, l’échéance des contrats est une période particulière : si en cours d’exécution de leur contrat, les concessionnaires sont incités à bien entretenir le réseau, ces incitations s’amenuisent à la fin du contrat.
Pour l’ART, il convient d’être vigilant sur deux aspects :
- Un effort supplémentaire d’entretien, pour un montant de l’ordre de 1,2 milliard d’euros, apparaît nécessaire s’agissant des chaussées et ouvrages d’art. Par exemple, certains ponts, dits « évolutifs », sont susceptibles de se dégrader structurellement d’ici quelques années : il s’agira d’en réduire le nombre en réhabilitant, a minima, ceux dont l’état le nécessite à brève échéance. En effet, ces travaux nécessitent une connaissance approfondie de l’infrastructure – il est donc indispensable qu’ils soient réalisés par l’actuel concessionnaire.
- Au-delà des chaussées et ouvrages d’art, le patrimoine autoroutier comprend une multitude d’autres actifs qui ne doivent pas être négligés. Par exemple, les équipements de signalisation, les bassins d’assainissement ou les infrastructures de péage sont indispensables à la bonne exécution du service. Ils comptent pour environ le tiers des dépenses totales d’entretien, soit 250 millions d’euros chaque année.
TOUS LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS AUX CONTRATS N’ONT PAS ENCORE ÉTÉ RÉALISÉS
Les contrats de concession prévoient la réalisation de certains aménagements en deux phases – par exemple, une section d’autoroute peut être construite à 2×2 voies dans un premier temps, le contrat prévoyant qu’elle comporte 2×3 voies à terme.
Or, il n’y a pas de consensus sur la portée des obligations relatives aux investissements de seconde phase, plus précisément sur la question de savoir si ces investissements sont en tout état de cause exigibles sans compensation par le concédant au plus tard à l’échéance du contrat.
L’enjeu est de taille : entre 0,4 et 5,1 milliards d’euros d’investissement pourraient être dus par les concessionnaires selon la lecture qui est faite des clauses contractuelles. Dans l’hypothèse où certains aménagements n’apparaîtraient plus justifiés aujourd’hui au plan technico-économique, ces montants pourraient être réutilisés à d’autres fins que des élargissements, par exemple pour financer l’adaptation du réseau aux besoins des mobilités du quotidien ou de décarbonation des autoroutes.
Selon l’ART, il existe des arguments juridiques forts en faveur de la lecture la plus stricte des obligations contractuelles des sociétés concessionnaires d’autoroutes.
En tout état de cause, compte-tenu de l’échéance prochaine des contrats, il faut statuer au plus vite sur l’étendue des obligations d’investissements restant à la charge des concessionnaires. C’est à l’État-concédant, en tant que responsable de l’exécution des contrats et garant de l’intérêt général, qu’il appartiendra de le faire, le cas échéant sous le contrôle du juge.
ALORS QUE LEUR ÉCHÉANCE APPROCHE, LA RENTABILITÉ DES CONCESSIONS HISTORIQUES NE PEUT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME EXCESSIVE
Leur échéance étant proche, il est possible d’estimer la rentabilité des concessions sur toute leur durée : celle-ci est cohérente avec le coût du capital pouvant être estimé sur la durée des contrats et avec les aléas d’une concession. En formulant des hypothèses prudentes quant aux obligations de fin de contrat, le taux de rentabilité interne (« TRI ») des sept sociétés concessionnaires historiques privées s’établit à 7,9 %. Ce niveau est à comparer au coût du capital qui, sur la durée allant de l’origine des concessions autoroutières historiques à nos jours, et pour un investissement de ce type, est de l’ordre de 7,0 %. Compte-tenu des aléas qui touchent l’activité d’un concessionnaire, mais aussi des nombreuses hypothèses qui ont dû être prises pour calculer le TRI et le coût du capital, cet écart n’est pas significatif.
Consulter :
- L’Essentiel de la troisième édition du rapport sur l’économie générale des concessions ;
- Le rapport intégral
- Press release in English
Contact presse : Karine Léopold, Cheffe du service communication
Karine.leopold@autorite-transports.fr
À propos de l’Autorité de régulation des transports
Depuis 2010, le secteur ferroviaire français est doté d’une autorité indépendante qui accompagne son ouverture progressive à la concurrence : l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf).
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a élargi les compétences du régulateur aux activités routières – transport par autocar et autoroutes. Le 15 octobre 2015, l’Araf est ainsi devenue l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), avec la mission de contribuer au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des clients des transports ferroviaire et routier.
Compétente pour la régulation des redevances aéroportuaires depuis le 1er octobre 2019, l’Arafer est devenue l’Autorité de régulation des transports (ART) à cette date. Enfin, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a étendu les compétences et missions de l’Autorité à l’ouverture des données de mobilité et de billettique, ainsi qu’à la régulation des activités de gestionnaire d’infrastructure et des activités de sûreté exercées par la RATP en Île-de-France.
Ses avis et décisions sont adoptés par un collège composé de cinq membres indépendants choisis pour leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport, ou pour leur expertise des sujets de concurrence. Il est présidé depuis le 29 décembre 2023 par Thierry Guimbaud.